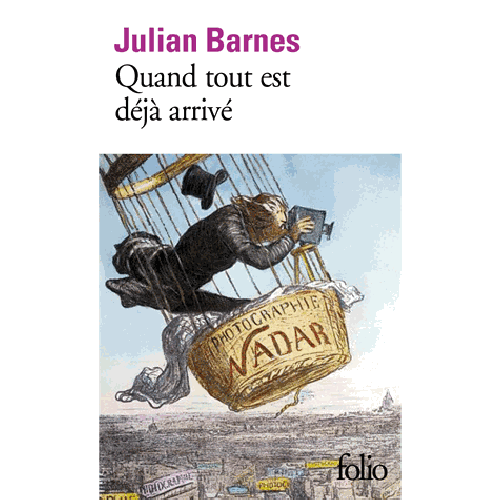Julian Barnes est un des auteurs britanniques que je chéris.
Il a l’art d’être précautionneux dans ses mots comme dans les sentiments qu’il prête à ses personnages, sans rien qui flamboie ou qui choque, et par cela même il émeut et ébranle. Mais en entamant Levels of Life, j’ai dès les premiers mots été décontenancée : le verbe y semble plus terne, et la phrase plus lente qu’à l’habitude. Le narrateur part en avant, revient en arrière, une pesanteur mélancolique empreint les deux premiers récits. Et pourtant ce devait être trois nouvelles aériennes, peignant l’homme dans les airs (« Le péché d’élévation »), sur terre (« A hauteur d’homme ») et d’un point de vue indéfini (« La perte de profondeur »).
Je lis donc les deux premières nouvelles, et suis interloquée. Trop bien ficelées, trop ancrées dans les détails historiques, je trouve plates les aventures aéronautiques de Nadar, photographe visionnaire du XIXè siècle qui prit les premiers clichés de topographie aérienne, et les aventures amoureuses de Fred Burnaby, passionné de montgolfières et de Sarah Bernhardt. Si le sujet nous intime de nous élever dans les airs, de voir le monde au-dessus des nuages tant par la rencontre scientifique passionnée de l’air et de la photographie, que par la rencontre amoureuse d’un officier anglais et d’une actrice avant-gardiste… je n’ai jamais tant eu l’impression de rester terre-à-terre chez Barnes qu’ici.
Mais l’art spécifique de la nouvelle anglo-saxonne n’est, au grand jamais, celui d’un roman en miniature : d’intrigue il n’y a pas, non plus que de finalité évidente. La nouvelle est un moment qui se suffit à lui-même. Et qui, peut-être seulement, dira quelque chose. Et ici, ce n’est qu’avec la dernière nouvelle que l’ensemble des récits prend son sens.
Car entre l’air et la Terre, là où s’épanouissent les visions de Nadar et les émois de Burnaby, il y a cet entre-deux fait de rêve et de désir, exactement ce qui pousse à s’aventurer vers les contrées et les êtres inconnus. A aller de l’avant. Le vent nous y pousse mais nous n’avons aucune prise sur lui : qui sait où il nous mènera, terre amie ou terre ennemie, qui sait surtout dans quel état il nous laissera reprendre pied sur la terre ferme…
Avec « La perte de profondeur », on perd pied justement.
Tourmente qui nous arrache de Terre, le style se fait plus impératif, les phrases plus abruptes, et l’enchaînement des scènes et des raisonnements plus serré : non que le narrateur s’empare de nous, mais il s’enfonce seul et conte et dit et raconte, et vous n’avez d’autre choix que de le suivre.
« Vous réunissez deux êtres qui n’ont encore jamais été mis ensemble. Parfois c’est comme cette première tentative d’associer un ballon à hydrogène et un ballon à air chaud : préfère-t-on s’écraser et brûler, ou brûler et s’écraser ? Mais parfois cela marche, et quelque chose de nouveau est créé, et le monde est changé. Puis à un moment ou à un autre, tôt ou tard, pour telle ou telle raison, l’un des deux est emporté. Et ce qui est retiré est plus grand que la somme de ce qui était réuni. Ce n’est peut-être pas mathématiquement possible, mais ça l’est en termes de sentiment et d’émotion ».
En quelques mots, le sens est là. Celui de la mélancolie sans espérance qui affleure dans les deux premières nouvelles : après la folle équipée de la photographie aérienne et des tentatives aérostatiques, on finit non pas sur Terre, mais sous Terre.
Six pieds dessous.
C’est avec une pudeur douloureuse que Julian Barnes évoque la mort de son épouse. Trente-sept jours pour être terrassé, témoin impuissant, dévasté, laissé en deuil. Il raconte le soudain engloutissement de tous ses sens, il dit comment il ne sait plus et ne veut plus savoir comment vivre sans elle. S’accrocher aux bribes du souvenir, subir l’effacement de la réalité par les mots obséquieux ou par l’évitement, décortiquer les phrases toutes faites et les réconforts qu’il ne peut envisager que comme des leurres. Précautionneux, il ne s’attache qu’aux détails pragmatiques : un pont traversé, une baignoire et un couteau japonais, des mots à un dîner. « Quelqu’un manque », c’est certain. Et toutes ces précautions ne font que dévoiler plus encore la brutalité du face à face entre l’auteur et la mort d’un être aimé, d’une vie à deux, d’un avenir, et d’un passé aussi. L’auteur perd pied. Il perd de vue le fond et les hauteurs. Et il nous renvoie à une situation que tous, nous savons être possible, probable, mais à laquelle rien ne peut préparer.
Saisie. Et bouleversée.
Je ne m’attendais pas, les deux premières nouvelles passées, à cela. A ce que Julian Barnes abandonne soudain les vies des autres pour parler de la sienne, à ce qu’il ajoute dans cette virée à chaque étage de la vie un palier où l’on sent que chaque mot a été arraché du néant. C’est bien là où Quand tout est déjà arrivé, le titre français du recueil, pêche. Non, tout n’est pas déjà arrivé : il reste toujours dans un couple cet inconnu qui adviendra, et pour lequel aucun rêve, vision ou souvenir ne nous viendra en aide. Pour l’affronter, on sera immensément seul.
Barnes nous rappelle que pour voler, il faut être plus lourd que l’air.
Que pour voler, il faut être à deux.
Alors comment faire quand quelqu’un manque ?
Julian Barnes, Quand tout est déjà arrivé, Mercure de France, 2014.
 (2)Boah...
(2)Boah... (0)
(0)