J’ai commencé par Easton, le milieu de l’oeuvre, le tournant des années 1980-1990.
C’était encore l’époque où je regardais les têtes de gondole et suivais les modes littéraires, l’époque où je ne fuyais pas les rentrées littéraires et les annoncés-best-sellers. American Psycho et Glamorama ont éclipsé un temps tout le reste, et Easton a pris le pas sur Bret et Ellis. Puis, un ami américain m’a offert Les Lois de l’Attraction, et j’ai découvert Bret. Meilleur encore que les romans suivants, le summum de l’écriture ellisienne dans les couloirs de la vie étudiante. Et une rencontre bressane m’offrit des années plus tard l’origine de l’oeuvre : 1985 et les premiers pas de l’Enfant terrible de l’Amérique… Peut-être un jour un ami d’ailleurs encore me fera entrer dans le Ellis des années 2000.
*****
Moins que zéro, et déjà le décor est planté.
Le lecteur sait qu’il va basculer sous la limite. La limite de la décence, des relations humaines, la limite de ce qui est légal et accepté et acceptable. Les baby-boomers ont refaçonné le monde américain en poussant la recherche du bonheur individuel au maximum, le culte de l’apparence se nourrissant de la presse à grand tirage et de la télévision avec boulimie, alors… à quoi pourraient bien rêver leurs enfants comblés matériellement ? de quoi héritent-ils et de quoi manquent-ils pour créer leur vie ? C’est l’interrogation fondamentale à laquelle a été (et est toujours) confrontée la Génération X, celle des années 1970 et du tout début des années 1980, la mienne. La génération qui explore la désagrégation psychique et sociale d’un monde où le déclin et l’ennui pourraient être les rois. Et en être les lois.
Court instant dans la vie de Clay, Moins que zéro relate les vacances de Noël de ce jeune étudiant dans sa famille sur la Côte Ouest. Et l’incipit d’offrir le tremplin pour la plongée : « Les gens ont peur de se perdre sur les routes de Los Angeles ». Le ton est donné : le mépris amer et cynique face à l’absence évidente et absolue de repères dans la vie, des jeunes et des moins jeunes, de ceux qui devraient être guidés et de ceux qui devraient les guider. Le lecteur descend alors doucement dans un Enfer tel celui décrit par Dante, fait de répétition et de monotonie. Le quotidien anesthésie le lecteur dès les premières pages lues et un décor permanent, comme de carton-pâte, envahit les lieux et les êtres : le faux à outrance et les pelouses éternelles, le critère excluant du bronzage et l’enjeu exclusif de la prochaine soirée, qui couche avec qui parmi les connaissances et parmi les parents. Et les 150 pages suivantes ne seront que la répétition lancinante de ces thèmes, engourdissement des sens et des raisons, provoquant une inquiétude sourde chez le lecteur : pendant cette anesthésie involontaire, que va faire de moi le chirurgien-auteur…
Jamais au grand jamais il n’y a de « pourquoi » chez Bret Easton Ellis. Il se refuse à l’exploration, à l’explication, il livre le monde tel qu’il le ressent : la vitrine n’est qu’une vitrine et, bien pis, elle se veut vitrine et ne prétend jamais être autre chose. Il n’y a rien derrière. Et il n’y a rien à gagner et rien à perdre dans ce monde car rien n’a de valeur. La Génération X est celle du cynisme, du fait de sa conscience acérée du déclin et de la précarité. Et Bret Easton Ellis fascine et façonne pour une bonne raison : son univers bien délimité l’est par un style qui recourt en permanence à l’écriture blanche. Volontairement dénudée, prétendument sans effet mais ne vous y laissez pas tromper car c’est un effet de style en tant que tel, elle apporte par l’absence d’implication de l’auteur et d’émotion un jugement moral sans appel. Le style blanc est le tribunal des lecteurs : voici les faits, un monde amoral où l’Indifférence est élevée en religion, jugez. C’est ce qui met si mal à l’aise, bien plus que les scènes sordides ou révoltantes décrites dans ce roman ou les suivants, cette question qui transparaît en permanence entre les lignes : toi, finalement, ne serais-tu pas tout aussi indifférent à ce que je te décris ? à ce que tu vois ? à ce que tu vis ? Ne consommes-tu pas tout autant que mes personnages l’adrénaline, la déchéance et la douleur ? ne t’en repais-tu pas tout autant qu’eux ?
Certaines scènes dans l’univers linéaire de Moins que zéro auraient en effet du être des acmés de répulsion, d’indignation et de colère : mêlant nihilisme et hédonisme, les jeunes filles et jeunes hommes traversent Los Angeles et la vie en s’injectant une adrénaline déjà périmée avant même que d’être sortie de la seringue. Toujours plus de drogues, de sexe, de violence qui aboutissent à plus d’hébétude, de vacuité et de solitude. Une sorte de cercle infernal où le plus amène le moins. Et le lecteur anesthésié par la litanie de trajets sans queue ni tête, de réflexions sans but, oublie presque lui aussi de réagir.
Le but est atteint, Bret, le but est atteint…
Car dans ce monde sans foi, sans loi, il aurait été trop facile de haïr les personnages et la vie qu’ils mènent. Si l’on est touchés par les personnages dérangés et désaxés d’Augusten Burrhough ou de Donald Coupland, l’écriture blanche oblige le lecteur à s’impliquer, à ressentir la douleur que le narrateur éprouve face à sa propre hébétude et à celle de ceux qui l’entourent. Et c’est dans ce jeu que peut se révéler enfin une étrange et inattendue compassion de l’auteur, incarnée dans l’angoisse de mort omniprésente… Etonnante chez un narrateur d’une vingtaine d’année, encore plus chez un auteur de seulement 18 ans, elle s’installe, à mesure que la grand-mère décline, qu’étincellent sous le soleil les carcasses de voitures ayant manqué un tournant de Mulholland Drive, à mesure que le coyote agonise sous les roues, que les parents disparaissent sous leurs implants capillaires, dentaires et leur bronzage…
Ce que l’accumulation sans émotion de kilos de coke et de médicaments, de litres d’alcool, de trajets infinis n’avaient pas réussi à faire tant cela constitue la normalité acceptée, l’accumulation d’un snuff movie, de la prostitution de luxe, d’un viol et de la contemplation apathique d’un cadavre d’homme y parvient et fait basculer Clay sous la limite. En-dessous de zéro. Il en aura fallu beaucoup mais il découvre alors, dans la tension des 20 dernières pages, qu’il tolère certaines choses mais n’en tolère pas d’autres. Qu’il existe en lui une échelle de valeurs qu’il ne connaissait pas ou n’avait jamais connue. Qui ne lui avait pas été transmise. Il passe en dessous de zéro et comprend qu’il y a quelque chose à perdre là. Il ne sait pas quoi. Il ne sait pas qu’une certaine humanité se joue là.
Mais il sait qu’il doit fuir.
*****
Elvis Costello est la voix qui résonne dans la chambre de Clay tout comme sa chanson « Less than Zero » résonne dans le roman. Le Oswald (Mosley) de la chanson et sa British Union of Fascists, dans l’univers de télévision décrit, incarnent ce fascisme du quotidien qui déshumanise les autres et soi, abreuvés d’informations scandalisant à bon compte et provoquant des réactions outrées et sans distance. Constat musicale d’une lente décomposition du lien familial et social, d’une mise à distance à travers l’écran télévisé, d’une mise à l’épreuve de notre propre humanité.
Car c’est elle, la clef du roman. Où se situe-t-elle quand on est si proche de zéro…
« There is a vacancy waiting in the English voodoo » ? Cette place vacante à, selon Ellis, été remplie par le culte de l’apparence d’une génération entière dont le rôle pourtant aurait du être envers la génération X, envers Clay, de « teach him he’s alive before he wishes he was dead » …
 (0)Boah...
(0)Boah... (0)
(0)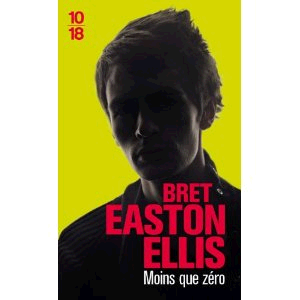
Je suis dingue des livres Easton-Ellis. Je l'ai découvert avec l'innommable et abominable mais tellement génial American Psycho ... et j'ai pas réussi à m'en défaire depuis.
@ Sekh Met : je ne me suis pas du tout plongée dans les derniers ! Qu'en as-tu pensé ? à la même hauteur ?